
Gouvernée par un Conseil de trente-six membres concentrés exclusivement à la Capitale, l’Université d’État d’Haïti (UEH) rassemble un vaste personnel d’environ 1,800 professeurs, plusieurs centaines de cadres du personnel administratif et plus de 30,000 étudiants répartis sur le territoire national. Ce riche réservoir du capital humain du pays regroupe onze entités dans l’Aire métropolitaine de Port-au-Prince (AMP), sept facultés et écoles de droit de province et le Campus Henry Christophe de Limonade. Dans une exclusion patente, le collège de trente-six dénommé Conseil de l’Université (CU) dont le recteur, les deux vice-recteurs, onze professeurs, onze étudiants et onze doyens est constitué uniquement des onze entités de l’AMP. Le Conseil de l’Université, dans sa configuration actuelle, encourage des collusions claniques et des pratiques discriminatoires. Par exemple, c’est par le leadership de l’UEH, assuré au plus haut niveau par son rectorat composé du recteur et des deux vice-recteurs, que le budget de l’UEH est discuté auprès des ministères concernés. Également, la plupart des coopérations internationales requièrent l’approbation du rectorat, quitte à ce qu’elles doivent être entérinées au sein d’une faculté spécifique. Puisque ce Conseil détient le pouvoir exclusif d’orienter la vision stratégique de l’Université, les entités de province n’occupent aucune place d’influence sur l’échiquier de la politique académique. Un véritable coup de massue à la tête de l’inclusion et de l’équité qu’il faudrait réparer. Les pratiques universitaires doivent s’aligner avec les nouveaux paradigmes qui font la promotion de la méritocratie indépendamment de l’appartenance ethnique ou de l’origine géographique.
La mission fondamentale de l’Université s’explique par l’exigence, au sein de la société, de disposer d’un répertoire de personnalités aptes à produire des réflexions critiques pour stimuler l’évolution sociale, économique et politique (Wolff, 2017). Cette lourde attribution devrait intégrer objectivement toutes les ressources humaines de cette entité pour les mobiliser dans les structures incluant celle de sa gouvernance. Pourtant, les statuts régissant la gouvernance de l’UEH ne favorisent pas un processus inclusif et représentatif pour désigner ses dirigeants. Le constat navrant d’un cadre légal de l’UEH – truffé d’exclusion et de lacunes technico-juridiques qui prêtent le flanc aux grognes et altercations entre les entités qui la composent – remonte à plusieurs décennies. Par crainte de s’attaquer à des intérêts de chapelle ou d’hypothéquer leurs projets de réélection, les recteurs et vice-recteurs se montrent inaptes à proposer des corrections systémiques pour amorcer des changements structurels et améliorer les services fournis par l’Université.
Tant de pratiques méritent des révisions sans délai afin d’incorporer une dimension holistique et participative de la gouvernance universitaire. Vingt-huit ans après la mise en œuvre des dispositions transitoires (UEH, 1997), les représentants de l’UEH languissent à matérialiser la réforme nécessaire au rehaussement du panorama académique. En absence de mesures d’intégration des entités sous sa tutelle, l’UEH ne pourra pas converger avec efficacité vers les standards requis de la formation tertiaire. Si les périodes électorales mettent à nu un ensemble de dérives de l’Université, un recul cartésien nous permet d’indexer des facteurs plus profonds qui ternissent l’image de cette noble institution.
Dans le fond, les litiges au sommet de l’UEH relèvent davantage d’un dysfonctionnement structurel plutôt que des symptômes en périphérie souvent reflétés dans les scènes de scandales offertes à la société. Les résultats des élections contestés en sont les principaux indices. Il convient de mentionner aussi les rôles inversés des étudiants manipulés constamment par des acteurs corrompus du système pour bloquer les cours, prendre en otage les entités, brûler des pneus pour faire passer des revendications. La charte même de l’UEH, allouant une latitude injustifiée aux étudiants notamment dans les structures électorales, souffre de normes qui favorisent des pratiques éthiques et efficientes. Conformément aux plaidoiries qui font la promotion du rôle central de l’Université dans l’orientation des politiques publiques, afin de mieux garantir le bien-être sociétal, la réforme de la gouvernance de l’UEH s’avère incontournable. Avant que la société fasse pleine confiance à l’UEH pour aborder à bon escient les véritables enjeux de société, cette entité élitiste doit faire preuve d’un comportement proactif de sa propre gestion.
Au préalable, un ensemble des corrections internes doivent être apportées par cette entité appelée à éclairer la lanterne des décideurs sur les politiques publiques. À titre d’exemple, l’UEH doit revisiter l’organisation des élections de ses dirigeants, promouvoir l’harmonisation des programmes d’études, garantir la gestion rationnelle de son personnel et repenser la composition de son Conseil de direction. D’une part, elle doit enlever les onze sièges du CU accordés à des étudiants afin de renouer avec une dynamique éthique. D’autre part, elle doit accorder un poids au corps enseignant provincial dans la gouvernance de l’Université. Sinon, aucun signal crédible n’est lancé pour indiquer un changement de direction dans les affaires de l’UEH, hypothéquant ainsi sa crédibilité dans les projets de société auxquels elle est censée mettre ses empreintes en vue de mieux les valider.
Pouvoir de négociation disproportionnel
Dans le cadre des élections, de manière implicite ou explicite, les candidats et les votants réagissent en optimisant les payoffs de leurs actions, comme en théorie des jeux (Acemoglu & Robinson, 2006). Si les candidats courtisent les électeurs pour les élire à leurs postes, les électeurs détiennent une position stratégique où ils exercent un pouvoir de négociation pour influencer les programmes selon leurs doléances. En toute logique, il n’existe pas un meilleur moment que le temps des hostilités électorales pour exposer les besoins de fonctionnement et d’investissement des facultés évoluant sous l’auspice du rectorat de l’UEH. À partir du vote, qui est un véritable instrument de pression, les électeurs agissent en fonction de leurs intérêts économiques et sociaux. Dans une connotation négative, ce pouvoir de négociation des électeurs est intégré dans une logique de clientélisme et d’échange de faveurs, susceptibles de déboucher sur un cercle vicieux de corruption. Scénario très plausible alors dans le cas de l’Université d’État d’Haïti qui souvent badine avec la façon de renouveler son personnel dirigeant. Tant par la forme du scrutin souvent décrié que par la composition de ses votants, fragilisée par un remarquable quota d’étudiants, les élections de l’UEH sont entachées d’imperfections. Celles-ci compromettent la légitimité des dirigeants élus. Depuis l’intronisation du recteur Pierre Paquiot en 1998 jusqu’aux récentes élections du recteur Dieuseul Prédélus au Rectorat, ce sont sur fonds de contestation que les recteurs sont installés à l’UEH. Dieu seul sait combien de coopérations l’UEH a loupées en raison de cette incapacité de soigner son image.
Les représentants dotés du privilège exclusif de désigner les recteurs et vice-recteurs pour piloter la politique de l’université ne proviennent que des onze entités de l’Aire métropolitaine de Port-au-Prince. Dans une mise à l’écart manifeste, les onze instituts abrités par l’AMP – Faculté d’agronomie et de médecine vétérinaire (FAMV), Faculté des sciences humaines (FASCH), Faculté des sciences (FDS), Faculté de droit et des sciences économiques (FDSE), Faculté d’ethnologie (FE), Faculté de linguistique appliquée (FLA), Faculté de médecine et de pharmacie (FMP), Faculté d’odontologie (FO), Institut d’études et de recherches africaines d’Haïti (IERAH/ISERSS), Institut national d’administration, de gestion et de hautes études internationales (INAGHEI) et École normale supérieure (ENS) – sont les seuls habilités à se rendre aux urnes pour élire les recteurs de l’UEH. Garnies de leurs trois représentants au CU, les entités de l’AMP sont les seules qui disposent des cartes d’atout qui leur accordent le plein droit d’influencer le jeu à l’avantage de leurs entités d’attache. À l’inverse, puisqu’elles n’ont pas de représentants au CU, les entités de province n’occupent aucune place décisive sur l’échiquier de la politique académique. L’UEH reproduit une injustice flagrante susceptible de déboucher sur des complexes entre diplômes en dehors et diplômes de la capitale. Comment l’UEH peut-elle continuer à ignorer dans son agenda électoral l’existence de l’Université de Limonade et des facultés et écoles de Droit et des Sciences économiques des provinces ?
Outre les imperfections d’ordre géographique et structurel, ce système électoral conçu pour plébisciter les recteurs de l’UEH par des petits copains de Port-au-Prince, souffre de multiples irrégularités techniques. D’une part, l’échantillon des électeurs est trop peu restreint pour s’assurer de sa représentativité par rapport à la population professorale et estudiantine. Ainsi, le risque d’ignorer les doléances de plus de trente-mille étudiants et près de deux mille professeurs est très élevé. Sur le marché du travail ou dans les lentilles des institutions pourvoyeuses de bourses d’études, un diplôme de la FDSE n’aurait pas la même valeur que celui obtenu de la Faculté et écoles de droit et d’économie de Hinche. Au lieu de s’ériger en autorité publique pour promouvoir l’inclusion et garantir à tous les citoyens un accès équitable aux opportunités, l’UEH perpétue des mécanismes de discrimination qui fragilisent l’équivalence de ses diplômes. Compte tenu des principes d’excellence et d’équité propres au milieu universitaire, il est impératif d’effectuer sans délai des ajustements aux modes de fonctionnement et aux procédures de désignation des représentants de l’Université d’État d’Haïti.
Un quart de siècle de traitement discriminatoire
Cela fait vingt-huit ans que l’Université d’État d’Haïti – qui est censée être la référence par excellence en matière de discernement, d’équité et de pensée critique – fonctionne dans cette vilaine dynamique d’exclusion de ses propres entités logées hors de la capitale. Depuis la création de l’Université en 1944, les entités provinciales n’ont jamais eu la voix au chapitre dans le choix des dirigeants. Jusqu’en 1997, le problème était commun à toutes les structures puisque la désignation des membres du Rectorat dépendait des caprices de la présidence. Les dispositions transitoires avaient annoncé un nouvel ordre, soi-disant démocratique en donnant la délégation à onze facultés de l’AMP de choisir les représentants du Rectorat. À la lumière des principes d’inclusion, cette option quoique sous-optimale demeurait préférable à une approche entièrement autoritaire. Depuis l’entrée en vigueur de cette transition jusqu’à date, les facultés et écoles de droit et d’économie des provinces restent à l’écart des orientations de la vision du plus grand institut d’enseignement supérieur du pays. Le Campus Henry Christophe de Limonade, construit au lendemain du séisme de 2010, appartient également à ce sous-ensemble traité en enfant pauvre dans les grandes décisions de l’UEH.
La discrimination à l’encontre de ces structures d’enseignement et de recherche en province qui, au même titre que les autres, sont des composantes à part entière de l’UEH, mérite d’être dénoncée. S’il en ressort constamment des candidats malheureux qui expriment manifestement leurs mécontentements face aux irrégularités des scrutins des recteurs et vice-recteurs, la catégorie d’étudiants, professeurs et doyens des provinces vivent leur exclusion des joutes électorales comme un traumatisme refoulé depuis des décennies. Les crises électorales conjoncturelles vers le renouvellement du Rectorat de l’UEH sont le reflet d’un problème structurel qu’il faudrait résoudre en profondeur en rompant avec les pratiques discriminatoires séculaires de citadins versus paysans. Une formation dispensée à la FDSE ou le diplôme décerné par cette entité de la capitale ne devait marquer aucune différence par rapport à la formation ou le diplôme décroché à la faculté de droit et d’économie du Cap-Haitien. Il est dommage que dans la réalité, la société exprime des préjugés vis-à-vis de deux licenciés issus de ces deux entités coiffées par une même institution.
En vertu des principes de justice sociale, la perception nourrissant les clivages et polémiques stériles entre la capitale et le pays en dehors devait être longtemps révolue. Il se trouve que les différences s’observent de manière concrète à travers les provisions budgétaires et les ressources humaines allouées de manière différenciée entre les entités de Port-au-Prince et celles des provinces. Les professeurs itinérants en mission pour animer des séminaires dans les provinces ne sauraient compenser cet écart abyssal. Ce biais originel provoqué à dessein par le système fait que cette perception d’une certaine supériorité d’un étudiant de Port-au-Prince en comparaison à celui de Jacmel, ne serait pas totalement erronée. Il est très plausible que la formation reçue à la FDSE soit de meilleure qualité en raison du capital humain et financier mobilisé dans cette aire géographique aux dépens du même département de la faculté du Cap-Haitien.
À l’origine des inégalités et des considérations discriminées qui en découleraient au sein des entreprises ou des programmes de coopération culturelle, il faudrait probablement noter que le pouvoir de négociation d’un doyen en province est moins élevé par rapport à son homologue de la capitale. Ce dernier a le pouvoir de voter, de siéger au Conseil de l’Université et donc d’avoir les oreilles des recteurs avec plus de facilité. Ainsi, il détient plus de latitude pour présenter des projets et défendre les intérêts de sa faculté pour ainsi obtenir une meilleure part du gâteau alloué à l’UEH. Quand les bourses d’études ou d’autres opportunités arrivent au rectorat, l’étudiant de Port-au-Prince, pouvant s’appuyer sur l’influence de son doyen voire sur la militance de son collègue au CU, détient une énorme longueur d’avance sur celui des Cayes. Au lieu d’être des motifs de démarcation, les différences – principaux facteurs de complémentarité – devraient plutôt constituer des atouts sur lesquels une société doit capitaliser pour mieux exploiter ses ressources. Il est temps que l’Université d’État d’Haïti apporte des corrections quant au traitement dédaigneux de ses propres structures provinciales.
Conclusion
La vocation de l’Université consiste à promouvoir la recherche, l’analyse critique et le développement des algorithmes des solutions aux enjeux et défis majeurs de l’ère contemporaine. Cette vision nécessite une approche intégrée où toutes les structures de l’Université sont mobilisées de manière harmonieuse. Les projets de société sont censés passer au moule fin des analyses académiques avant leur implémentation afin de mieux s’assurer de leur intérêt pour le bien-être sociétal. L’Université d’État d’Haïti (UEH) ne devrait pas être un contre-exemple par rapport à cette formule universelle gagnante qui veut que les institutions de réflexions et de la pensée critique participent de façon proactive au progrès de la société. À l’instar de la Stanford et Berkeley qui sont des piliers de la Triple Hélice de l’écosystème entrepreneurial de la Silicon Valley, l’Université haïtienne doit s’atteler à jouer un rôle clé pour alimenter la société de nouvelles idées aux germes transformateurs pour la création de nouvelles entreprises.
L’UEH devrait avoir un rôle central dans les nouvelles directions à marquer par Haïti pour emprunter la voie de l’émergence économique. Elle doit donc maximiser les chances de recevoir des productions interdisciplinaires, des réflexions et des critiques à propos des projets de société. Elle n’a ainsi aucun intérêt à mettre ses ressources à l’écart de sa gouvernance stratégique ou de son fonctionnement. En tant que l’une des plus importantes institutions de référence de l’élite intellectuelle, l’Université d’État d’Haïti (UEH) devrait prêcher par l’exemple. Elle devrait s’approprier la plaidoirie de Jean Price Mars en assumant son rôle de vigie et de pilier de la formation intellectuelle, d’intégration régionale, de l’épanouissement personnel et du progrès collectif. Une correction de la structure de gouvernance de l’UEH s’avère nécessaire afin de rompre avec la discrimination et les stéréotypes pour plutôt honorer les bienfaits de l’inclusion et de la diversité.
Carly Dollin
Pour consulter les articles précédents, cliquez ici
Références
- Acemoglu, D., & Robinson, J. A. (2006). Economic origins of dictatorship and democracy. Cambridge University Press.
- UEH (1997). La réforme de l’Université d’État d’Haïti. Dispositions transitoires relatives à l’organisation de l’administration centrale de l’Université d’État d’Haïti.
- Wolff, R. (2017). The ideal of the university. Routledge.
The post Conseil de l’UEH, expression d’une gouvernance asymétrique first appeared on Rezo Nòdwès.
Via Rezonodwes
Read original article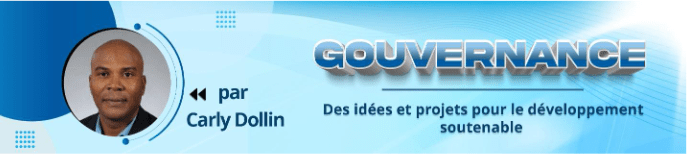
Comments (0)
Add a Comment
No comments yet